Maya Seminck, publié le 13 mars 2025
Les mots en gras et en rouge sont des liens cliquables, n’hésitez pas à être curieux !
Depuis toujours, la musique joue un rôle dans les mouvements de résistance à travers l’histoire, en particulier lors des guerres et des grandes oppressions. La musique a permis aux gens de se rassembler et de s’unir contre des régimes autoritaires. Dans les camps de concentration, la résistance pouvait prendre la forme de chants politiques, patriotiques, religieux ou encore des chansons détournées, dont les paroles dénonçaient les conditions de survie. La musique est un moyen de communication efficace qui peut toucher toutes sortes de publics. Les morceaux peuvent nous apaiser, nous mettre en colère, nous donner l’envie de résister, on peut pleurer, danser, chanter, rire. La musique nous transmet des émotions, et c’est grâce à ça que l’on peut s’y identifier.
En 1968, le chanteur Lluís Llach compose L’Estaca , le morceau s’impose rapidement comme un hymne de combat contre la répression franquiste. C’est un cri à l’unité d’action pour se libérer de l’oppression de la dictature du général Franco en Espagne.
C’est en juillet 1973, peu avant le coup d’état au Chili orchestré par la bourgeoisie chilienne, la CIA et le Général Pinochet, qu’est enregistrée pour la première fois la chanson El pueblo unido jamás será vencido. Les paroles ont été écrites par le groupe Quilapayún, et la musique composée par Sergio Ortega. Elle s’impose comme la chanson emblématique de la lutte pour la démocratie au Chili. Encore aujourd’hui, ce chant de liberté et d’unité populaire est repris dans de nombreuses manifestations prônant la justice sociale et la dignité des peuples d’Amérique du Sud.
Diffusée à la radio portugaise le 25 Avril 1974, la chanson Grândola, Vila Morena mit fin à la dictature que le Portugal endurait depuis 1933. C’est José Alfonso qui la composera. C’est ce chant que le Mouvement des Forces armées utilisera comme signal déterminant l’amorce de la rébellion militaire et de la révolution des Œillets.
En 1977, le morceau, 11min30 contre les lois racistes, est diffusé par un collectif de 19 artistes français. Le morceau est un signe de contestation contre les lois Debré, prolongement des lois Pasqua, qui durcissent les lois immigration en France.
Je ne veux pas faire de politique, ma mission est artistique mais quand je vois tout le trafic on ne peut pas rester pacifique
Ne pouvant pas exercer leur métier à cause de la pandémie Covid-19, le collectif français, HK et les Saltimbanks, a utilisé l’art, la culture et le lien social pour rassembler les gens en musique durant cette période de grand isolement. Sorti le 18 décembre 2020, le clip de la chanson Danser encore cartonne sur les réseaux. Une musique entrainante qui invite à danser, s’enlacer, ne pas se morfondre derrière la solitude que créée par la pandémie. L’envie de s’engager et de résister avec élégance et tendresse, face aux mesures asociales et autoritaires, était si puissante que s’en vraiment s’y attendre, ils ont lancé un mouvement international. En Russie, Pologne, France, Belgique, Portugal, Espagne, Allemagne, Suisse, La Réunion… les gens se rassemblent et chantent le morceau, Danser encore, adapté à leur propre langue.
Ci dessous le lien vers la vidéo YouTube qui retrace les mouvements solidaires internationaux pour la chanson Danser encore.
HK DANSER ENCORE worldwide • ultimat collection around the world • [Full Movie + subtitres f, e, d]
Lors du 1er tour des élections législatives de juin 2024 en France, le Rassemblement national (RN) passait en tête avec 29,25%. Dans la nuit du 1er juillet, un morceau engagé contre le RN intitulé No Pasarán est publié sur Youtube, 20 rappeurs y prennent la parole. Le morceau a été publié sur toutes les plateformes d’écoute, c’était un moyen de communication efficace qui, malgré ses polémiques, a permis de mobiliser des jeunes.
Les collectifs qui se rassemblent pour éveiller les consciences des citoyens, ce n’est pas récent.




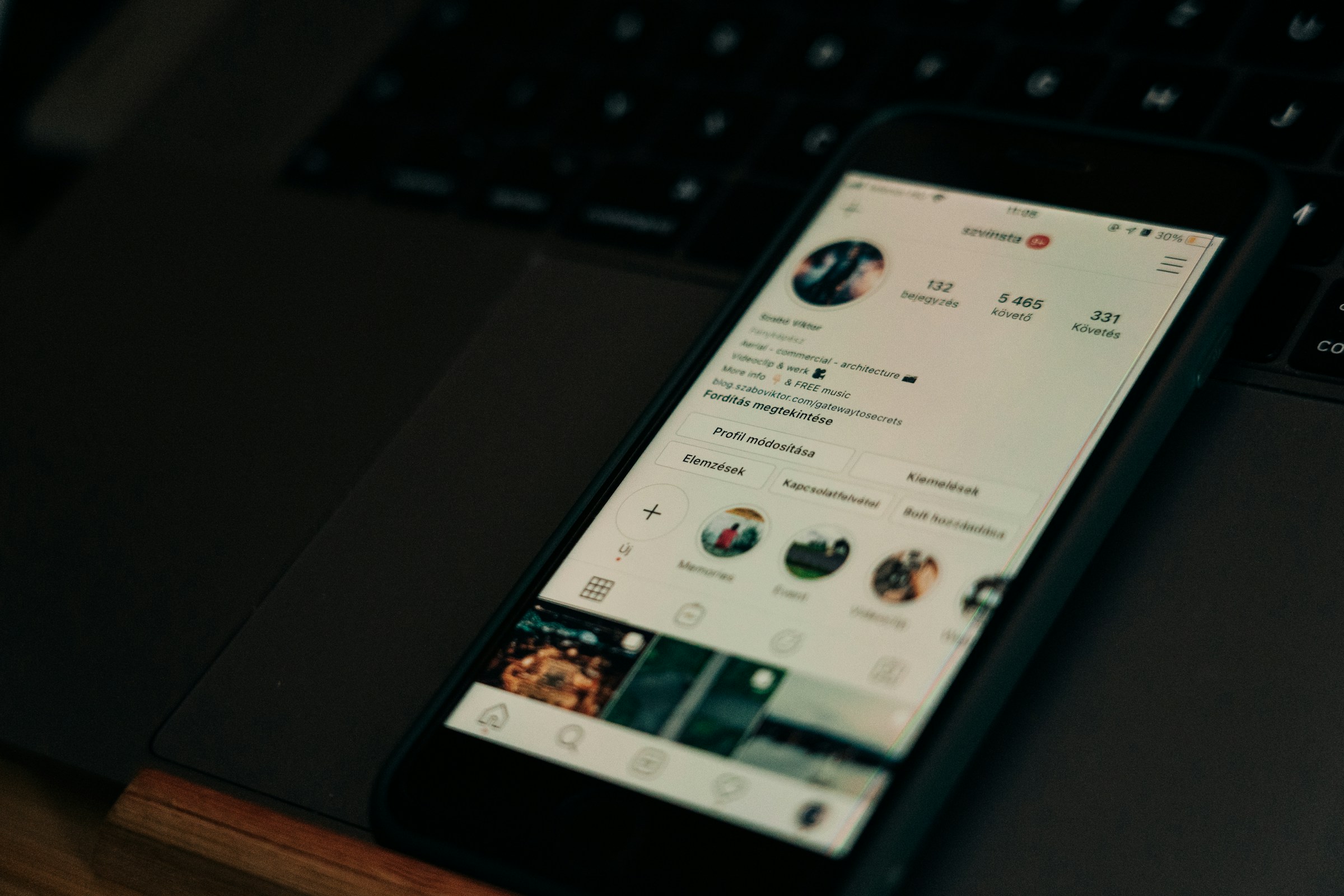


Laisser un commentaire