La lutte pour les mots et les mots de la lutte
Celui qui ne cède rien sur les mots, ne cède rien sur les choses Karl Kraus

Les mots sont importants. Bien plus qu’on ne le pense. S’arrêter sur ce phénomène n’est pas une forme de pinaillage sémantique ou une volonté pédante de se démarquer en pratiquant l’enculage de mouche. Ce n’est pas pour rien que nos adversaires politiques, depuis plusieurs décennies, s’évertuent par leur cadrage et par le choix des mots qu’ils veulent nous imposer se montrent intransigeants par rapport à ces mots imposés.
Ces mots imposés qui, par leur usage, peuvent induire une vision du monde. Notre postulat était en effet de dire, à l’instar de George Orwell et de Victor Klemperer (et de bien d’autres figures tutélaires) que les mots ne font pas que refléter le réel, ils le créent aussi : dans la vie politique et syndicale, le choix des mots n’est jamais anodin. En effet, le langage n’est pas un simple outil qui reflète le réel, mais il crée également du réel en orientant les comportements et la pensée. Pour le dire autrement, le langage revêt une importance capitale par sa capacité à imposer l’usage de certains mots ou de certaines expressions, tout en en interdisant l’usage d’autres. Cet outil de communication s’avère par conséquent aussi être un puissant outil de domination. Et vivre dans l’omission de cette évidence peut faire des ravages. Les mots portent, emportent avec eux une vision du monde, une logique politique, des marques de démarcation. Les mots classent, trient, délimitent. Et si nous n’y prenons garde, bercés que nous sommes par cette petite musique lancinante et constante, nous finissons nous –mêmes par ne plus parler notre propre langue mais la leur, celle qui occulte le conflit et naturalise à tout –va pour mieux ancrer en nous les dogmes de l’idéologie néolibérale et pour cacher le conflit, celle qui colonise notre trésor de mots pour les remplacer par les mots issus de la gestion et de l’économie. Une naturalisation qui conduit tout aussi naturellement à une dépolitisation de la politique publique. Ces mots qui « par leur travail d’euphémisation idéologique et de rationalisation de la réalité »[1] anesthésient notre vigilance.
La langue pense à notre place en quelque sorte Une langue qui a recours à l’euphémisme pour enserrer la réalité dans une représentation qui en gomme les aspérités, et qui en élimine les scories.
Quelques exemples pour illustrer ce propos :
Dans le champ de l’immigration, la N-VA a systématiquement parlé de « transmigrants », impliquant par là que les personnes qui arrivent sur le sol belge n’ont pas vocation à y rester et qu’il est donc tout à fait justifié de procéder de la manière dont Théo Francken a agi. L’usage de ce terme a été intériorisé dans le Nord du pays et est devenu inconscient, ce qui est loin d’être le cas en Belgique francophone et il n’est pas illusoire de voir un lien entre la résistance contre le politique migratoire et l’absence de recours à ce terme.
Autre exemple : « dans les mots du pouvoir néolibéral, la crise ne désigne plus un moment de transition mais un état normal et permanent justifiant l’éternel retour des réformes, assujettissant les populations à l’attente passive d’un rebond ou d’une relance »[2], sans oublier la sacro-sainte résilience, ce terme emprunté à la psychologie et dorénavant utilisé pour préparer à l’adaptation aux mesures austéritaires. Car il est aussi important de constater que nos adversaires n’ont « nul besoin d’inventer des mots pour transformer la réalité, une activité qui demande du travail et de l’imagination. Il est plus rentable d’investir dans la polysémie : risque minimum et rendement maximum »[3] : le meilleur exemple pour illustrer ce phénomène est ce magnifique étymon qu’est l’émancipation qui se voit essoré recyclé et détourné pour obtenir un sens purement purement économiciste (c’est ainsi que l’émancipation devient un projet individuel visant à quitter sa condition préalable pour rejoindre le cercle des puissants).
Ces mots écrans, ces mots en caoutchouc, ces mots vides qui travaillent au jargon des affaires et manigancent des faux débats sont de véritables mots poisons « qui brutalisent la langue de l’intérieur, portant la violence au cœur du discours à travers des néologismes qui colonisent les imaginaires ; le droit d’asile devient immigrationnisme, l’attachement à l’état social une défense de l’assistanat »[4].
Alors que la crise du coronavirus montre, illustre et démontre clairement l’échec du néolibéralisme, il est néanmoins amusant de voir les tenants de cette doctrine politique et économique recourir à une stratégie orwellienne visant à utiliser les mots de l’adversaire afin de camoufler ce que la crise dévoile. Ainsi, si Charles Michel appelle à « œuvrer à une société attentive et bienveillante pour plus de bien-être »[5], notre première Ministre par accident qui lui a succédé, Sophie Wilmès, n’a de cesse d’évoquer la solidarité dont il faudrait faire preuve face à l’adversité. Ce recours à ces termes, connotés positivement et fleurant bon l’entraide et la coopération visent bien évidemment à camoufler l’échec de la concurrence libre et non faussée. Cette opération de camouflage vise à déguiser la réalité dans le but de divertir l’attention : c’est une mascarade, une mise en scène trompeuse, un simulacre, une comédie fallacieuse.
De l’importance du cadre
Elucubrations et supputations gratuites ou volonté de créer un cadre propice et favorable à créer une certaine vision du monde ? George Lakoff définit les cadres comme étant « des structures mentales qui façonnent notre façon de voir le monde »[6] et il en indique immédiatement l’importance : « lorsqu’on parvient à modifier le cadre du débat public, on change la façon dont les individus perçoivent le monde. On modifie ce qui relève du sens commun. Pour penser différemment, il faut s’exprimer différemment. »[7] En somme, choisir un cadre revient à choisir les mots qui correspondent à une vision du monde. Ainsi, par exemple, les conservateurs états-uniens ont mis tout en œuvre pour remplacer le terme réchauffement climatique, jugé trop anxiogène et suggérant de surcroît une responsabilité humaine, par celui de changement climatique, plus neutre. Partant, nous décelons aisément l’intérêt d’un recadrage réussi : cette opération permet « d’insuffler un changement dans des millions de cerveaux pour qu’ils soient prêts à accepter une certaine réalité »[8], une réalité nouvelle qui permet de porter atteinte aux libertés fondamentales de toutes et tous sans coup férir et de dissimuler les causes à l’origine des maux qui déferlent.
Face à ces constats se pose bien évidemment la lancinante question de savoir ce qu’il convient de faire. Et, fort de cette lucidité, il s’avère alors tout aussi important et opportun de refuser ce cadre, de recadrer de manière permanente le débat public pour tâcher de le remettre sur d’autres rails pour emporter le sens commun. Et aussi de refuser ces mots qui, telle une sarabande entrent dans la danse comme dans une mascarade, ce divertissement d’origine italienne et de caractère aristocratique, constitué par des scènes ou des entrées allégoriques, mythologiques, satiriques ou burlesques de personnes masquées.
Concernant les mots, la première stratégie consiste à éclairer le vampire (car il ne supporte pas la lumière) et faire le pari que ce gain de lucidité ouvrira la voie à une certaine résistance, lexicale dans un premier temps, idéologique dans un second, car, ce nécessaire travail de déminage permet de procéder à un patient effort de reconceptualisation et de réappropriation que l’on aurait tort de dédaigner en n’y voyant qu’un pinaillage sémantique. Définir les mots est un acte politique. Qui en fixe le sens se dote d’un atout stratégique. »[9]
Partout, la vigilance sémantique gagne du terrain et permet ainsi de remettre dans le discours l’adversaire à sa place et à rendre à nouveau visible le rapport de forces. Cette stratégie qui vise à éclairer le vampire, dévoiler les impostures sémantiques et pratiquer la désobéissance sémantique peut opérer des renversements de perspective. Ce travail systématique de traque et de déconstruction de ces pirouettes sémantiques, de ces ruses de langage doit nous permettre de renforcer notre puissance de transformation du monde et d’œuvrer au « retour à des mots investis de sens, tous ceux que la gouvernance a voulu abolir, caricaturer ou récupérer : la citoyenneté, le peuple, le conflit, les classes, le débat, les droits collectifs, le service public, le bien commun… Ces notions ont été transformées en “partenariat”, en “société civile”, en “responsabilité sociale des entreprises”, en “acceptabilité sociale”, en “sécurité humaine”, etc. »[10]. Car les mots sont des forces politiques : »la reconquête idéologique sera lexicale ou ne sera pas »[11], et la bataille des mots est indissociable de la bataille des idées.
Le propos collectif est en somme de dire que nous préférons les mots adéquats et clairs au langage préfabriqué et standardisé.
En assumant la performativité du langage, les mots deviennent des outils de lutte, qui ouvrent le futur plutôt que ne le ferment, qui redonnent le pouvoir aux luttes d’en bas plutôt qu’aux experts, qui permettent de maintenir l’espoir plutôt que de le tuer.
[1] Alain Accardo, Le petit bourgeois gentilhomme, sur les prétentions hégémoniques de la classe moyenne, Marseille, Agone, 2020 p.102
[2] Guillaume Mazeau, Histoire, Paris, Anamosa,2020, p.30
[3] Ndongo Samba Sylla, ‘En Afrique, la promesse de l’émergence reste un mirage’, Le Monde diplomatique, juin 2020, p.10
[4] Vincent Martigny, ‘Le règne de la farce et de la tragédie », Le Un, n° 268, 16/10/2019, https://le1hebdo.fr/journal/pourquoi-les-populistes-seduisent/268/article/le-rgne-de-la-farce-et-de-la-tragdie-3522.html
[5] https://www.rtbf.be/info/monde/detail_charles-michel-appelle-a-uvrer-a-une-societe-attentive-et-bienveillante-pour-plus-de-bien-etre?id=10498322&utm_source=rtbfinfo&utm_campaign=social_share&utm_medium=fb_share&fbclid=IwAR0XltA887p5GKrnNFiAOwDaGAFaIl_8Ri1jKlFAfAlwpEIEkdN2aivtpDQ
[6] George Lakoff, La guerre des mots ou comment contrer la démagogie des conservateurs, Paris, Les Petits matins, 2015, p.12
[7] Idem, p. 13
[8] Idem, p.57
[9] Idem, p. 97
[10] Mathieu Dejean, ‘ comment les médiocres ont pris le pouvoir, entretien avec Alain Deneault’,http://mobile.lesinrocks.com/2015/12/01/actualite/comment-les-m%C3%A9diocres-ont-pris-le-pouvoir-11791161/
[11] Collectif Le Ressort, Reconquista, premiers rebonds du Collectif Le Ressort, Cuesmes, Le Cerisier, 2009,p. 66




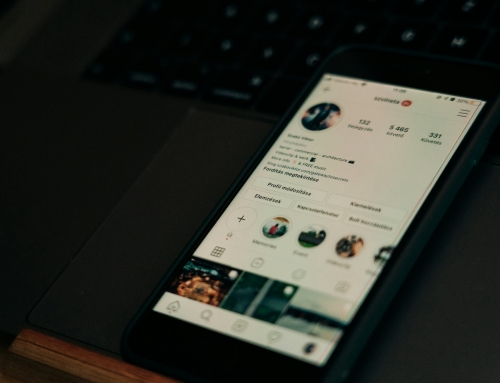

Laisser un commentaire